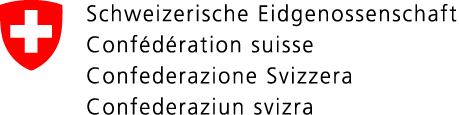Les substituts aux produits carnés et lactés connaissent un franc succès en Suisse. La directrice de la Swiss Food and Nutrition Valley Christina Senn-Jakobsen explique comment la production alimentaire se réinvente et crée, avec l'évolution des habitudes de consommation, de nouvelles opportunités de marché.
Près de six personnes sur dix (58%) évitent plusieurs fois par mois de consommer des produits d’origine animale en Suisse, selon une enquête représentative du distributeur Coop parue en 2024. Et le phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. Cette même année, 27% des ménages se déclaraient ainsi "flexitariens", contre seulement 18% en 2022. Pour remplacer l’apport en protéines présentes dans les produits d’origine animale, ou tout simplement varier les repas, certains se tournent vers des alternatives végétales (ou "plant-based"), destinées à remplacer non seulement la viande, mais aussi le lait, les œufs et le fromage, par exemple. Afin de s’adapter à ces nouvelles habitudes de consommation, de nombreuses start-up et PME établies de longue date actives dans l’agriculture, l’artisanat ou l’industrie alimentaire, proposent désormais des imitations de produits lactés ou carnés, qui ne contiennent aucun produit d’origine animale.
Comment expliquer le succès des alternatives végétales aux produits d’origine animale en Suisse?
Christina Senn-Jakobsen: Les habitudes alimentaires de la population changent depuis une dizaine d’années. Il ne s’agit toutefois pas d’une adoption à grande échelle de régimes végétariens ou véganes, mais d’une évolution progressive vers des régimes alimentaires flexitariens – moins centrés sur les produits carnés ou lactés –, en particulier chez les moins de 40 ans. Deux motifs principaux poussent les consommateurs à opter pour des aliments à base végétale: le changement climatique et la santé. Ces alternatives sont plus saines et que leur fabrication est moins polluante que celles des produits carnés ou lactés qu’elles imitent.
Comment les chaînes de production alimentaire (agriculteurs, artisans et industriels) peuvent-elles s’adapter à ces changements?
Senn-Jakobsen: Précisons tout d’abord que ces acteurs continueront de jouer un rôle majeur dans la production alimentaire et que les activités d’élevage et de transformation continueront aussi d’exister. Les chaînes de production pourront toutefois diversifier leur portefeuille d’activités en y ajoutant une nouvelle source de revenus. Les alternatives végétales de qualité, saines et riches sur le plan nutritionnel, sont en effet perçues par le consommateur comme des produits à forte valeur ajoutée.
En 2022, les subventions fédérales ont été élargies aux cultures de protéines végétales pour l’alimentation humaine. Des agriculteurs suisses ont ainsi pu intégrer le pois jaune dans leurs cultures, ouvrant la voie à une collaboration avec Planted, acteur clé du secteur des alternatives végétales en Suisse.
Les alternatives végétales sont issues de procédés de transformation, ce qui peut freiner certains consommateurs. Comment s’assurer qu’il s’agisse d’aliments sains?
Senn-Jakobsen: Je recommande aux consommateurs de vérifier la liste des ingrédients utilisés dans la fabrication des produits. En règle générale, plus cette liste est courte, plus le produit est sain. Il existe d’ailleurs des outils en ligne qui peuvent aider à faire des choix éclairés. Par exemple, l’application gratuite "Yuka" permet d’analyser la composition des produits et d’évaluer leur impact sur la santé grâce à des scores clairs. Le marché propose des options parfaitement recommandables sur le plan diététique.
Les acteurs économiques qui intègrent les alternatives végétales à leur portefeuille doivent réaliser des investissements dans leur exploitation ou entreprise. Comment limiter les risques?
Senn-Jakobsen: Les agriculteurs et industriels qui cherchent à transformer une partie de leur activité pour y inclure des alternatives végétales pourraient obtenir des fonds de soutien de la part des autorités. Il a en effet été démontré que l’alimentation basée sur les végétaux réduit les risques de maladies. Soutenir cette transition peut ainsi servir de levier aux autorités pour améliorer la santé publique et œuvrer pour une production alimentaire plus respectueuse du climat. Pour les acteurs économiques, il s’agit d’une manière de faire porter partiellement par la collectivité, le risque inhérent à chaque investissement.
Peut-on envisager une coopération entre les producteurs traditionnels et les fabricants d’alternatives végétales en vue d’améliorer la qualité de la production alimentaire?
Senn-Jakobsen: Cette coopération existe déjà, et a débouché sur des projets concrets. Le crémier végane "New Roots", installé dans le canton de Berne, a travaillé avec les artisans fromagers et leur infrastructure pour produire des fromages fabriqués à base de végétaux. En Allemagne, une célèbre marque de charcuterie fondée au XIXe siècle, Rügenwalder Mühle, a opéré une transition vers le végétal en s’appuyant sur son savoir-faire en matière de charcuterie. Aujourd’hui, les substituts végétaux représentent 90% de sa production.
Qu’en est-il de l’impact que pourrait avoir la viande cultivée en laboratoire sur le marché?
Senn-Jakobsen: Comme la demande en produits alimentaires augmente, la viande cultivée en laboratoire pourrait venir s’ajouter à l’offre de viande conventionnelle et d’alternatives végétales. Cette méthode de production de viande permet par ailleurs de réduire les émissions de gaz à effets de serre de près de 92%, et l’utilisation des terres de 90%. Ce domaine de recherche et d’activité représente donc une opportunité intéressante pour la Suisse. La commercialisation de la viande cultivée en laboratoire attend néanmoins encore d’être avalisée par les autorités.
En mai 2025, le Tribunal fédéral a tranché en faveur de l’interdiction d’étiqueter des produits d’origine végétale avec des termes animaux comme "poulet", "porc", "bœuf". Cette décision peut-elle influencer négativement le choix du consommateur?
Senn-Jakobsen: Non. En général, les consommateurs continueront d’opter pour une alimentation moins carnée, même avec les nouvelles normes d’étiquetage qui découleront de la décision du Tribunal fédéral. La population doit pouvoir faire des choix libres et informés. Les emballages ne doivent donc pas induire en erreur. Toutefois, il paraît judicieux que d’autres termes comme "steak" ou "filet" puissent encore être utilisés sur les étiquettes de produits non carnés afin que les individus soient informés sur la façon de cuisiner le produit.