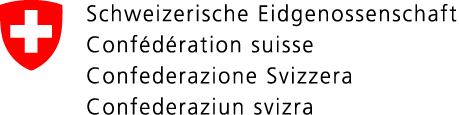Le secteur du bâtiment explore des solutions concrètes pour réduire son empreinte carbone, notamment dans la production de béton et d’acier. Spécialiste en matériaux de construction, Christian Paglia constate des avancées significatives, bien que plusieurs normes techniques doivent encore être adaptées.
La fabrication des matériaux de construction représente environ 10% des émissions de gaz à effet de serre en Suisse, selon l’Office fédéral de l’environnement. Cette proportion élevée s’explique notamment par la production de ciment et d'acier. Pour amorcer sa transition vers un modèle bas carbone, le secteur de la construction (qui pesait près de 35 milliards de francs, soit 5% du PIB en 2021) se réinvente à travers de nouveaux matériaux et procédés moins énergivores, comme celui du béton LC3. Les experts misent aussi sur la réutilisation des composants et sur la planification de la fin de vie des bâtiments, comme l’explique Christian Paglia, directeur de l’Institut Matériaux et Constructions de la Haute école spécialisée de Suisse italienne (SUPSI).
Quelles sont aujourd’hui les solutions techniques qui permettent de réduire les émissions de CO2 liées à la fabrication du béton?
Christian Paglia: Il faut se concentrer sur les solutions qui permettent de remplacer en partie le ciment Portland (ciment traditionnel riche en clinker, matériau dont la fabrication libère de grandes quantités de CO2, ndlr) par des solutions moins émettrices. L’une des recettes les plus prometteuses à l’heure actuelle reste sans doute le ciment LC3, qui contient une part importante d’argile calcinée et de calcaire. L’entreprise argovienne JURA a notamment élaboré un ciment de type LC3 100% suisse. Les chercheurs explorent aussi d’autres pistes, comme l’intégration de résidus agricoles (cendres de balle de riz, litières de bois) et de déchets d'incinération propres, à faible teneur en métaux lourds dans les ciments. Les normes établies par la Société suisse des ingénieurs et architectes permettent désormais l’homologation de ciments alternatifs, à condition qu’ils offrent les mêmes propriétés mécaniques que le béton traditionnel. Par exemple, le ciment de type CEM VI intègre des matériaux de démolition recyclés.
Autre aspect important: la réduction des distances de transports, grâce à l’utilisation de matériaux locaux. Cette démarche favorise en outre le développement de filières locales de fabrication et de recyclage qui rendent le secteur moins dépendant des importations.
L’acier est aussi une source importante d’émissions de CO2. Comment le rendre moins polluant?
Paglia: L’un des processus les plus efficaces consiste à recycler l’acier. À volume égal, le recyclage de l’acier à partir de ferraille émet environ 50% moins de CO2 que la production à partir du minerai. Aujourd’hui, l’intégralité de l’acier produit en Suisse émane de ce procédé de recyclage, qui utilise des fours à arc électrique plutôt que des fours à charbon, nettement plus polluants. Pour réduire encore davantage l’empreinte carbone, il faut aussi favoriser la réutilisation directe des composants en acier sans passer par le recyclage. Cette pratique existe déjà mais son déploiement à large échelle se heurte à deux obstacles majeurs: l’absence de normes claires encadrant la réutilisation et le besoin d’évaluer l’état de conservation des éléments en fin de vie.
La planification architecturale constitue également un aspect important afin de réduire l’empreinte carbone du secteur. Quels sont aujourd’hui les enjeux en la matière?
Paglia: Les constructeurs et les propriétaires commencent à mieux prendre en compte la fin de vie du bâtiment en vue de la réutilisation des matériaux. Il existe des solutions pour renforcer le potentiel de réutilisation, notamment en favorisant l’homogénéisation et la préfabrication des composants. Toutefois, la branche manque de lignes directrices claires pour améliorer les éléments préfabriqués et les assemblages.
Pour les entreprises, quelles sont les opportunités économiques qui émanent de la décarbonation?
Paglia: Un changement dans la technologie des matériaux peut être considéré comme une grande opportunité pour la valorisation des ressources locales. Dans cette optique, on peut par exemple prioriser l’utilisation de cendres de bois locales pour remplacer des composants importés. Une autre solution consiste à réutiliser des matériaux cimentaires boueux issus des bétonnières. Plutôt que de les mettre en décharge, on peut intégrer ces résidus dans la production du béton pour réduire la teneur en ciment Portland, principal émetteur de CO2. À la SUPSI, nous préparons actuellement des projets en ce sens, en coopération avec un producteur de béton installé dans la région.
Des projets innovants ont permis de construire des immeubles avec peu d’émissions de CO2 et d’en faire des puits de carbone, en utilisant notamment du béton de chanvre. Ces solutions sont-elles prometteuses?
Paglia: L'utilisation du béton de chanvre est intéressante pour l'isolation thermique et acoustique. Sur le plan de la réduction de l’empreinte écologique, le béton de chanvre présente des avantages mais peut aussi être plus difficile à réutiliser car il ne possède pas exactement les mêmes propriétés mécaniques. Il faut aussi s’assurer que le chanvre soit d’origine durable.